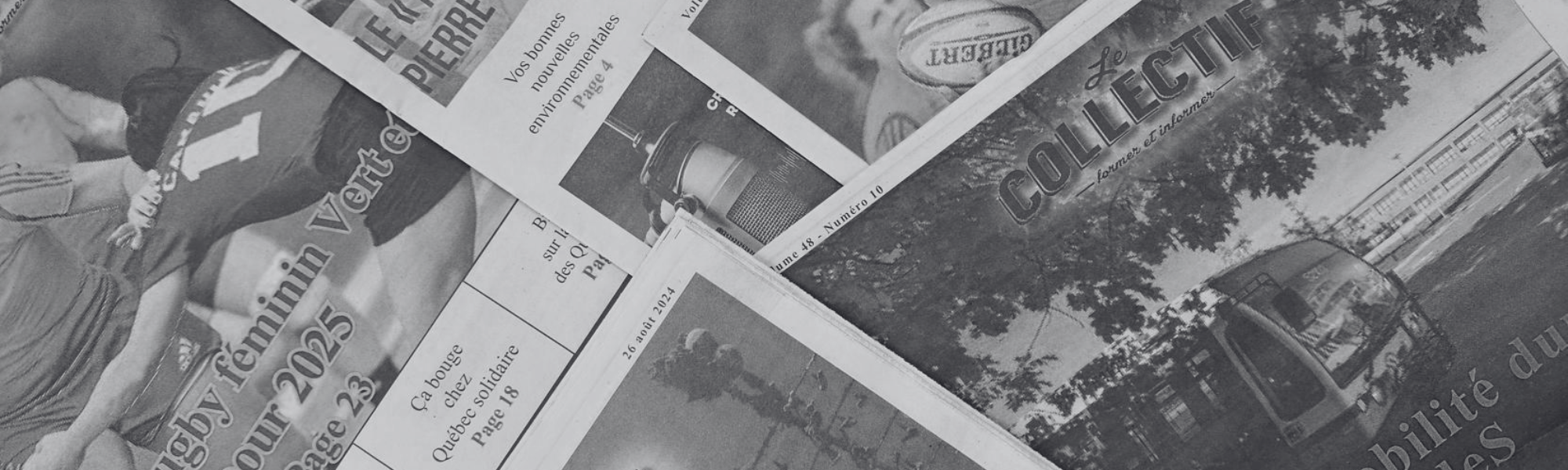Par Sarah Gendreau Simoneau

La semaine dernière, le ministre de la Langue française, Jean-François Roberge, a déposé un nouveau règlement pour empêcher l’utilisation d’appellations inclusives, comme le pronom « iel », le mot « toustes », ou encore la fusion de deux flexions en utilisant un point comme dans « étudiant.e ».
Le but est de vouloir mettre fin à « la confusion linguistique dans les communications de l’État québécois ».
La nouvelle mesure s’appliquera aux ministères, aux sociétés d’État, aux municipalités et aux organismes publics de la fonction publique québécoise, ainsi qu’aux réseaux de la santé et de l’éducation, par l’intermédiaire de leur ministre respectif.
Cependant, les écoles de la province ne seront pas touchées. M. Roberge affirme qu’il « ne veut exclure personne ».
« Le français, notre langue officielle qui nous unit collectivement, ne doit pas être dénaturé. Il doit demeurer accessible pour en faciliter sa compréhension et son apprentissage. Conserver une cohérence dans les communications de l’administration permet d’être compris par le plus grand nombre de personnes », commente le ministre Roberge.
Québec affirme avoir mis à jour la Politique linguistique de l’État « en conformité avec les recommandations de l’Office québécois de la langue française (OQLF) ».
Ainsi, la politique indique que l’utilisation du masculin générique est « acceptable, notamment en alternance avec les doublets et avec des formulations neutres ». Selon le ministre Roberge, « de plus en plus » de fonctionnaires avaient recours à l’écriture inclusive, ce qui menait à une « incohérence » dans les communications.
Ça sert à quoi l’écriture inclusive ?
« Dans la langue française, il y a deux genres, masculin et féminin, et la langue inclusive a pour objectif d’élargir cet usage et d’inclure toutes les personnes », explique la présidente de l’Association canadienne de linguistique, Julie Auger.
« Pendant plusieurs décennies, l’objectif était d’inclure les femmes. Aujourd’hui, il s’agit d’inclure une diversité de genres », poursuit celle qui est aussi professeure à l’Université de Montréal.
Julie Auger voit un recul avec cette interdiction, alors que « le Québec a toujours été novateur pour la féminisation comme pour la reconnaissance des personnes non binaires dans la langue ».
« Oui, les néologismes posent certains problèmes, mais de là à les retirer… C’est difficile de croire qu’il n’y a pas une prise de position plus ou moins directe contre la diversité », déplore-t-elle.
Qu’en est-il des personnes non binaires ?
L’OQLF ne conseille pas le recours à ces pratiques rédactionnelles en référence à l’utilisation de néologismes qui ne sont ni masculins ni féminins. « Ces usages restent propres aux communautés de la diversité de genres », précise la Vitrine linguistique de l’Office.
Si on s’adresse à une personne non binaire ou qu’on la désigne précisément, l’Office propose, dans la mesure du possible, d’omettre les marques de genre et les titres de civilité féminins et masculins, comme madame et monsieur.
Ce que ça veut dire, en vertu des nouvelles mesures, c’est que les personnes qui n’utilisent pas les pronoms « il » ou « elle » ne pourront être interpellées par leurs pronoms de choix dans les communications de l’État. Une forme évitant les marques de genre sera plutôt privilégiée.
Le ministre Jean-François Roberge a toutefois précisé qu’il n’y avait « pas d’enjeux » quant à la présence des pronoms préférés dans la signature des employés de la fonction publique, que ceux-ci soient des pronoms non binaires, féminins ou masculins.
Diviser pour mieux régner ?
En ce qui concerne les autres partis, Paul St-Pierre Plamondon, chef du Parti québécois (PQ), a approuvé le règlement, malgré son mécontentement au sujet de l’absence de réflexion lors de la prise de décision. En revanche, Québec solidaire accueille cette nouvelle avec une opinion plus négative. « Voulez-vous bien me dire de quoi la CAQ a tant peur ? », soulève Manon Massé, responsable solidaire en matière d’affaires LGBTQ+. « Personne n’a demandé ça. Ils inventent des problèmes pour détourner l’attention de son bilan minable en éducation. »
La libérale Marwah Rizqy, cheffe de l’opposition officielle, critique également le sens des priorités du gouvernement sur la question du français. Elle affirme que le discours devrait être plus important par rapport à la connaissance du français.
Privilégier l’écriture épicène (pas interdire l’écriture inclusive), oui, même l’Université de Sherbrooke le fait. Mais bannir l’écriture inclusive reste un choix idéologique. La langue n’est pas souvent neutre. Ce qu’on choisit de nommer ou d’enlever traduit une vision de la société. Derrière l’argument de « clarté » se cache une volonté de maintenir une norme masculine au détriment de la visibilité des autres. Limiter l’écriture inclusive, c’est limiter les représentations possibles. C’est choisir ce qui a le droit d’exister dans l’espace public et institutionnel.
Source : Un Monde Meilleur

Sarah Gendreau Simoneau
Passionnée par tout ce qui touche les médias, Sarah a effectué deux stages au sein du quotidien La Tribune comme journaliste durant son cursus scolaire, en plus d’y avoir œuvré en tant que pigiste durant plusieurs mois. Auparavant cheffe de pupitre pour la section Sports et Bien-être du Journal, et maintenant rédactrice en chef, elle est fière de mettre sa touche personnelle dans ce média de qualité de l’Université de Sherbrooke depuis mai 2021.